Il est loin, le temps où les flâneurs avaient la ville pour terrain de jeu et pour seul but l’espoir de l’inattendu ou de la beauté. Les cités, censées être des lieux de vie, sont devenues les vitrines aseptisées d’un modèle normalisant, sécuritaire, où les espaces de consommation envahissent les lieux de rencontre. Les badauds sont contrôlés par les caméras, les pauvres sont repoussés dans les périphéries, et les artistes sont cachés agonisants dans les musées.
Dans la grisaille ambiante certains arrivent à raviver les couleurs du passé. Les souvenirs d’une ville ne sont pas si faciles à effacer. Les pierres ont beau être nettoyées, la pelouse plantée, les temples construits, les marches n’oublient pas le sang versé. Là où débutèrent les premiers combats le 18 mars 1871 de ce qui deviendra la Commune de Paris, a été construite, quatre ans plus tard, une église dite du Sacré-cœur ; rien de moins qu’une insulte à ceux qui s’étaient battus pour leur liberté.
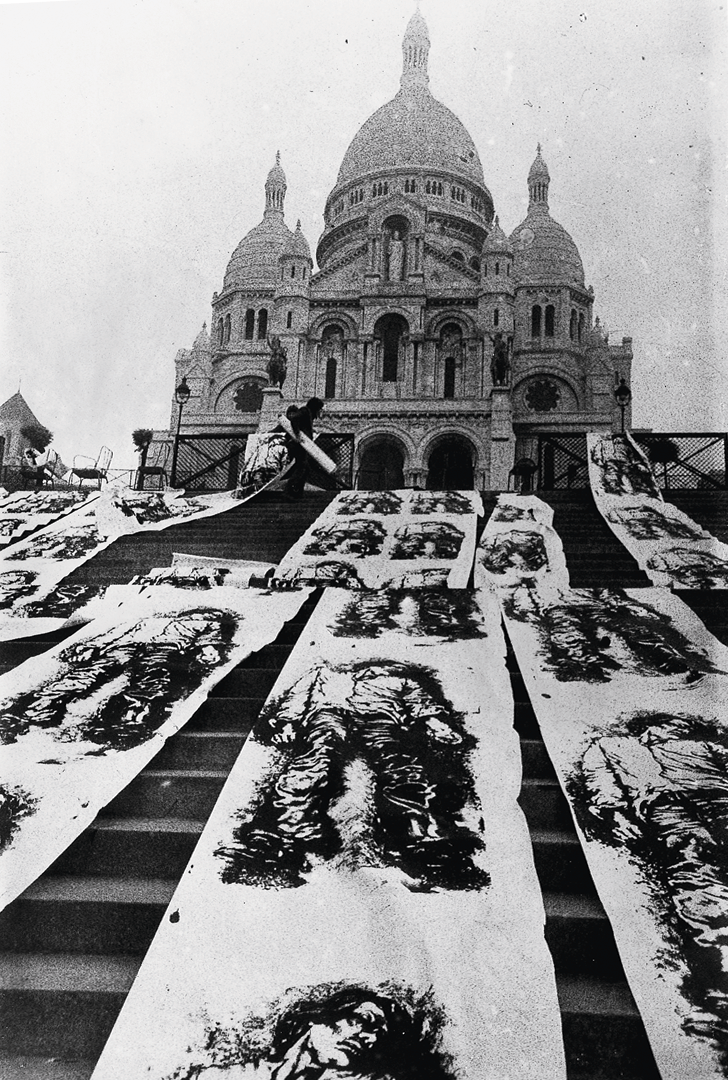
Ernest Pignon Ernest, Les Gisants de la Commune, Paris, 1971
A l’aide d’une presse sérigraphique (technique rendue populaire pendant Mai 68, voir Le Poing n° 16), les Gisants de la Commune, renaissent par centaines, dans les rues de Paris en 1971. Extrêmement réalistes, à l’échelle 1, les dessins de ces corps vont imprégner les pavés et coller aux marches des lieux d’une répression sanglante. Si l’histoire a honoré à de trop nombreuses reprises et dans de trop nombreux sites le nom d’Adolphe Thiers, sous nos pas, les anonymes ressurgissent par le biais de l’artiste Ernest Pignon Ernest, dans les rues d’une ville pour laquelle ils sont morts.
L’artiste est un passeur. Par l’image fictionnelle il réveille un passé enfoui, des causes légitimes et plus que tout un espoir renversant venu de ceux qui ont su, un jour, se saisir de leur vie. A nous, à leur exemple, de nous réapproprier un espace qu’on nous vole petit à petit. Nous marchons, respirons dans ces rues, nous les usons, les reconstruisons et pourtant nous oublions cette évidence que les villes appartiennent à ceux qui les habitent. Elles sont une extension de nous-même, car les rencontres, les convictions et les révolutions ne se font pas derrière des murs.
Le chat
* Extrait d’une lettre de Gustave Courbet à ses parents, 30 avril 1871